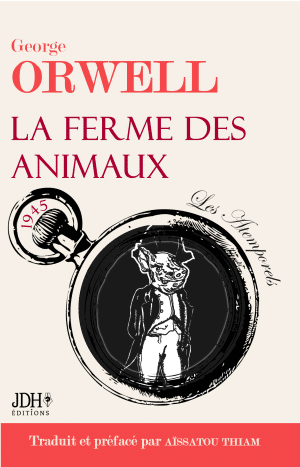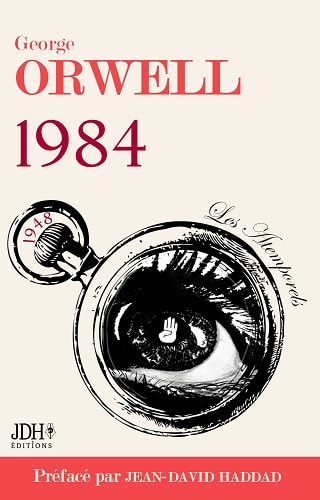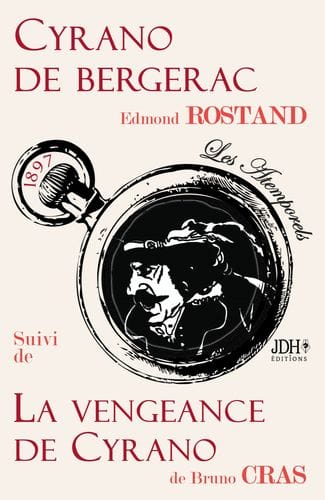Notre collection de classiques de la littérature s’enrichit encore avec Guillaume Apollinaire et « Les Onze mille verges Ou les amours d’un hospodar », qui paraîtra prochainement sous le format des Atemporels. Voici en avant-première, une partie de la préface des Onze milles verges, dans une édition enrichie par la biographie de l’auteur, sa bibliographie et une préface nourrie et développée en plusieurs parties. 12 titres sont désormais disponibles dans cette collection, de George Orwell à Edmond Rostand, à Gustave Le Bon ou Edmond Rostand et quelques autres. À lire et relire sans modération.
Les Onze mille verges Ou les amours d’un hospodar est peut-être le roman le plus connu de l’œuvre de Guillaume Apollinaire, il fut publié en 1907 et signé de ses initiales « G. A. ». Il faudra d’ailleurs attendre les années 2000 pour que la paternité de l’œuvre lui soit reconnue, pleine et entière, si j’ose m’exprimer ainsi. On y trouvera même des extraits des Amours naturalistes d’Edmond Dumoulin et une adaptation d’un roman anonyme publié à Berlin en 1900, portant sur « les lubricités enfantines », ceci d’après les notes personnelles de Guillaume Apollinaire lui-même.
À la lecture de l’œuvre, on pourrait se croire navigant dans le menu déroulant des sites pornographiques d’aujourd’hui. Apollinaire catégorise les perversions et explore sans complexe « la foutrerie » dans son ensemble, alternant les genres, dans « une joie infernale ». Masochisme, sadisme, zoophilie, vampirisme, nécrophilie, gérontophilie, saphisme, onanisme, orgies, pédérastie, scatophilie et compagnie y sont de revue. Dans un style cru et humoristique, l’auteur décrit « la fabuleuse histoire » de Mony Vibescu, « Héro » d’un périple sexuel et voyageur.
Le roman sera adapté au cinéma en 1975, sous le même titre, par Éric Lipmann, et un roman graphique sera réalisé, par le très talentueux dessinateur érotique Liberatore (la saga Ranx), également sous le même titre. C’est d’ailleurs sous cette forme que le jeune homme que j’étais alors, a découvert en médiathèque Les Onze mille verges. En parcourant ces pages sulfureuses, j’avais pensé que ma petite amie et moi avions encore, mais alors beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Je n’ai eu de cesse, ma vie restant, de me passionner pour le sujet. Avec plus ou moins de succès, mais toujours avec curiosité. Et dévouement.
Nous sommes entrés dans une époque que d’autres générations ont connue avant nous. Une époque terne et pandémique, avec pour témoins une jeunesse sage et rangée. Secrète. Avec une « vieillesse » prudente et taiseuse. Et paradoxalement, l’imagerie pornographique n’a jamais été aussi présente sur ce que les sociologues nomment « les nouveaux médias ». Mais, aujourd’hui, les mœurs d’hier ne sont plus celles que notre société disciplinée et lissée, politiquement correcte et à l’imagination stérile, accepte. Si je prends une définition commune à plusieurs supports du web, pour le mot « pornographie », j’obtiens ceci :
La pornographie est la « représentation complaisante – à caractère sexuel – de sujets, de détails obscènes, dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique, cette représentation explicite d’actes sexuels finalisés ayant pour but de susciter de l’excitation sexuelle ».
Et cette définition est bien triste, comme les mœurs de l’époque.
Peu festive.
Antipoétique.
Non amoureuse.
Et sa conclusion est très dommageable pour le genre.
Car il n’y a pas « une pornographie » à mon sens, mais 11 000, au minimum…
En cela, Apollinaire avait raison. Apollinaire et Sade, et Musset, et Miller, et Anaïs Nin, et Gainsbourg, et Buñuel, et Sand, et Colette, et Réage, et Bergman, et Vadim, et Manet, et Schiele, et Oshima, et Jaeckin, et Manara, et Pichard, et Wolinski et j’en passe. Je pourrais noircir de noms des dizaines de pages, dans tous les arts, y compris la musique classique et l’architecture. Les références pourraient surprendre. La pornographie ne cherche pas seulement à exciter « le client ». Contrairement à ce qu’en dit cette définition. Elle n’est pas toujours racoleuse. Elle sait aussi se montrer esthétique et intimiste. Elle est une contre-culture utile. L’art graphique comme la littérature, comme le cinéma, comme la chanson, comme la photographie, comme la haute couture, nous l’ont prouvé à maintes reprises. Nombre de propos artistiques, d’idées nouvelles et, osons le dire, de révolutions culturelles, sont passés par le sexe pour impacter leurs époques respectives. Ceci pour vous dire que votre pornographie cesse où commence mon érotisme.
Car, si pour beaucoup, l’érotisme est la petite sœur plus sage de la pornographie, je n’adhère pas au concept. Des images choquantes pour certaines personnes sont anodines pour d’autres, et vice versa. Lacan et Freud vous l’expliqueront beaucoup mieux que moi. Je vous invite à lire leurs conférences respectives à la psychanalyse.
Le mot « pornographie » est en lui-même synonyme de « sale », « grossier » ou « vulgaire ». L’érotisme, par contre, est considéré comme un mot « palier ». Plus intimiste. Plus « propre ». Plus « esthétique ». « Plus artistique ». Pourtant, le sujet est le même : « le cul ».
Et on y retrouve non seulement les mêmes ingrédients que dans la pornographie, mais aussi les mêmes fétiches et totems et bien souvent les mêmes acteurs et actrices. Depuis que le monde est monde, on n’a rien trouvé de mieux que le sexe pour exprimer l’amour, le vice et la vertu…
La morale, puisque je viens d’écrire le mot « vertu » avec lequel il s’associe volontiers, est une histoire d’époque. De contexte. De mœurs. Une jeune fille ou un jeune homme de seize ans qui découvrait les joies du sexe et de l’amour dans les années 60-70, cela ne choquait personne. Le naturalisme et l’éducation sexuelle bourgeoise étaient en vogue. Le répertoire littéraire comme le répertoire cinématographique sont emplis de références sur les amours débutants. De nos jours, traiter le sujet, c’est s’offrir un aller simple pour le comité de censure, voire pour le tribunal. Dans les années 70-80, la violence urbaine et le sadomasochisme dominaient dans les œuvres à « caractère pornographique » ou érotique. En cela, il y a un parallèle à faire avec les années 50 et les fameux « films noirs » (Howard Hugues et les comités de censures qui mesuraient au compas les poitrines des actrices). Dans les années 90-2000, le voyeurisme et l’aventure « exotique » en parodies avaient le vent en poupe. De nos jours, c’est « le couple » et sa portée « sociale » qui dominent. Ou encore l’homosexualité. Mais beaucoup plus confidentiellement que jadis. Ainsi que l’exploration des pratiques sexuelles diverses et variées, à grand renfort de gadgets et de prises de tête plus ou moins philosophiques et psychologiques.
Seulement, aujourd’hui encore, d’autres mots viennent en renfort à la définition négative de la pornographie, d’autres idées associées non plus à l’émancipation sexuelle de la femme, au droit à l’orgasme, à la liberté d’expression, mais au féminisme radical, à l’image « pieuse » de la femme, à la « sexploitation » mafieuse et donc aussi à la prostitution. Par associations d’idées. Et pourtant, la prostitution passe pour être le plus vieux métier du monde.
Les champs de représentation du sexe à travers les âges sont un sujet si vaste que l’édition française réunie n’arriverait pas à publier toutes ses pages. C’est pourquoi, loin de toutes ces divergences d’opinions et ce vadrouillage intellectuel que je vous livre ici sans calculs, j’aime lire ce texte d’Apollinaire au « cul Rabelaisien », « Pasolinien » et heureux. Sans complexes. Sans censure. Sans gorille en slip (car aujourd’hui, on en mettrait un d’office à celui de Brassens) et sans prétention. La nature est bien faite, je ne pense pas avec mes organes génitaux. Mon cerveau est bien fait, je ne cherche pas de traces de Descartes ou de Kant dans un film X. Et ce que j’y cherche me regarde. Comme le disait Anatole France : « De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. »
Les Onze mille verges, comme Le jardin des supplices ou Gamiani, sont des œuvres inclassables et dérangeantes. Les résumer au mot « pornographie » serait idiot. Et c’est moralement insatisfaisant. Les excès, les supplices, le pal, les vampires et les viols, les accouplements hors normes, les orgies et le désespoir du membre, l’amour et la beauté, les fantasmes et le réalisme outrancier, la merde et le sang sont les étapes nécessaires qui mènent à un accouchement : celui de l’humain.
De 1907 à 1970, ce livre fut édité et vendu clandestinement. Ce n’est qu’à partir de 1970, et grâce à Régine Desforges, que ce classique put enfin être diffusé librement. « Il y met en scène presque tous les fantasmes et tabous érotiques possibles et célèbre les femmes girondes aux chairs épanouies… »
Apollinaire y brosse les folles aventures du prince Mony, un souverain roumain à l’appétit sexuel débordant. Du Paris bourgeois du début du XXe siècle jusqu’au Port Arthur exotique de la guerre russo-japonaise de 1905, il s’ébat de toutes les façons possibles et imaginables avec une foule de protagonistes féminines. Plus pulpeuses et plus rabelaisiennes les unes que les autres. Il finira par mourir flagellé par un corps de l’armée japonaise, « châtié par onze mille verges », accomplissant ainsi sa destinée pour avoir failli à son serment, que voici :
« Si je vous tenais dans un lit, vingt fois de suite je vous prouverais ma passion. Que les onze mille vierges ou même les onze mille verges me châtient si je mens ! »
Une fin romantique, comme la sienne le sera, au final. Celle d’un romantisme à l’Apollinaire.
(Suite à parution.)
Préface de Yoann Laurent-Rouault, pour JDH éditions.