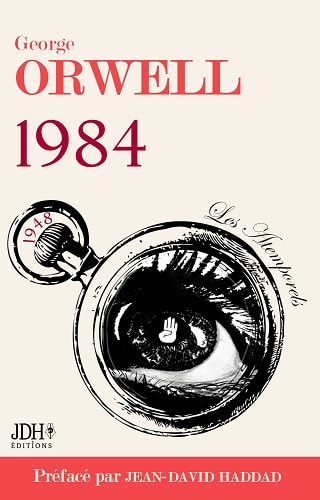Extraits de la préface
« Big Brother is watching you. » Cette célèbre phrase imprègne tous les esprits lettrés depuis la publication du roman de George Orwell. Dans 1984, il y a cette omniprésence incarcératrice des écrans, cette surveillance des faits et gestes de chacun. La réalité du XXIe siècle est moins brutale en apparence, mais tout aussi insidieuse, quand on sait qu’avec notre consentement, nos téléphones portables, ordinateurs, webcams et autres objets connectés peuvent savoir tout de nous : nos données, notre mobilité, notre santé, etc.
…
Si vous voyez 4 doigts mais que la pensée unique, relayée par votre gouvernement, par les médias, les réseaux sociaux, les organisations internationales, vous demande d’en voir 5… combien en voyez-vous ? 4 ou 5 ? Réfléchissez… Et lisez Orwell !
Première page
C’était une belle journée d’avril, l’air était frais et les pendules sonnaient treize heures. Winston Smith, le menton collé contre sa poitrine dans l’espoir d’échapper au vent glacial, se glissa rapidement entre les portes en verre des immeubles de la Victoire, mais pas assez vite pour empêcher un tourbillon de poussière et de sable d’entrer avec lui.
Le couloir sentait le chou bouilli et le vieux paillasson moisi. Au bout de ce couloir, une affiche en couleur, trop grande pour être affichée en intérieur, avait été fixée à l’aide de punaises. Elle se composait simplement d’un visage immense, de plus d’un mètre de large : le visage d’un homme d’environ quarante-cinq ans, arborant une épaisse moustache et des traits d’une beauté sauvage. Winston se dirigea vers les escaliers. Inutile d’essayer l’ascenseur. Même dans les bons jours, il fonctionnait rarement. À présent, le courant était coupé pendant la journée. Cela faisait partie de la campagne de restrictions budgétaires en vue de la Semaine de la Haine. Son appartement se trouvait au septième étage, et Winston, qui avait trente-neuf ans et traînait un ulcère variqueux au-dessus de sa cheville droite, monta lentement les marches, faisant de nombreuses pauses dans son ascension. Sur chaque palier, à l’opposé de la cage d’ascenseur, l’immense visage de l’affiche l’observait depuis le mur. C’était l’un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblaient vous suivre lorsque vous bougiez. Big Brother vous surveille, disait la légende en dessous du visage.
Page 30
Dans sa deuxième minute, la Haine engendra une certaine frénésie. Les spectateurs bondissaient de leurs sièges et hurlaient à s’en arracher les cordes vocales, dans le but de noyer le bêlement exaspérant de la voix provenant de l’écran. Le visage de la petite femme aux cheveux blond roux avait viré au rouge vif ; sa bouche s’ouvrait et se fermait comme celle d’un poisson hors de l’eau. Même le visage dur d’O’Brien était cramoisi. Il était assis bien droit sur sa chaise, son torse puissant se gonflant et se contractant comme pour résister à l’attaque d’une vague. La fille brune assise derrière Winston avait commencé à hurler « Fumier ! Salaud ! Ordure ! », et soudain, elle attrapa un gros dictionnaire novlang et le lança sur l’écran. Il frappa le nez de Goldstein avant de rebondir ; la voix continua, implacable. Dans un moment de lucidité, Winston s’aperçut qu’il hurlait de concert avec les autres et qu’il frappait violemment ses talons contre le barreau de sa chaise. Concernant les Deux Minutes de la Haine, le plus horrible n’était pas le fait que chacun fût obligé d’y prendre part, mais au contraire, qu’il était impossible d’éviter d’y participer. Au bout de trente secondes, toute simulation devenait inutile. Une extase hideuse de peur et de haine, un désir de tuer, torturer, fracasser des têtes avec une masse, semblait gagner toutes les personnes présentes comme un courant électrique, transformant chacun en un fou qui grimaçait et hurlait, même contre sa volonté. Et pourtant, la rage que chacun ressentait n’était qu’une émotion abstraite et indirecte qui pouvait passer d’un objet à un autre comme la flamme d’un chalumeau. Ainsi, à un moment, la haine de Winston n’était plus du tout dirigée vers Goldstein, mais, au contraire, vers Big Brother, le Parti et la Police de la Pensée ; et dans des moments comme celui-ci, son cœur allait à l’hérétique solitaire et ridiculisé présent à l’écran, unique gardien de la vérité et du bon sens dans un monde de mensonges.
Page 284
Il s’était légèrement déplacé sur le côté, afin que Winston puisse avoir une meilleure vue de la chose posée sur la table. C’était une cage rectangulaire en fils de fer, avec une poignée sur le dessus pour la transporter. Sur le devant était fixée une chose qui ressemblait à un masque d’escrime, dont la partie concave serait tournée vers l’extérieur. Bien qu’elle fût placée à trois ou quatre mètres de lui, il vit que la cage était divisée sur la longueur en deux compartiments, et que chacun d’eux abritait une créature. C’étaient des rats.
— Dans votre cas, la pire chose au monde se trouve être les rats, constata O’Brien.
Une sorte de tremblement prémonitoire, une peur d’il ne savait pas vraiment quoi, avait traversé le corps de Winston dès qu’il avait aperçu la cage pour la première fois. Mais à cet instant, la signification du masque fixé au-devant le pénétra soudain. Ses entrailles semblaient s’être liquéfiées.
— Vous ne pouvez pas faire ça ! hurla-t-il d’une voix forte et éraillée. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas ! C’est impossible.
— Vous rappelez-vous le moment de panique qui arrivait souvent dans vos rêves ? demanda O’Brien. Il y avait un mur de ténèbres devant vous, et un rugissement dans vos oreilles. Il y avait quelque chose de terrible de l’autre côté de ce mur. Vous saviez que vous saviez ce que c’était, mais vous n’avez pas osé le soumettre à votre conscience. C’étaient des rats qu’il y avait derrière ce mur.
Dans les appendices, au sujet du Novlang :
Le mot « penser », par exemple, n’existait pas en novlang. Il fut remplacé par « pensée », qui faisait à la fois office de nom et de verbe. Aucun principe étymologique n’était suivi ici ; dans certains cas, c’était le nom original qui était gardé, et pour d’autres, c’était le verbe. Même dans le cas où un nom et un verbe au sens semblable n’étaient pas reliés étymologiquement, l’un ou l’autre était souvent supprimé. Par exemple, le mot « coupure » n’existait pas, car sa signification était assez couverte par le nom-verbe « couteau ». Les adjectifs étaient formés en ajoutant le suffixe -able au nom-verbe, et les adverbes par le suffixe -ment. Ainsi, « vérité » laissait place à l’adjectif « véritable » et à l’adverbe « véritablement ». Certains de nos adjectifs actuels, comme « bon », « fort », « gros », « noir », « doux », furent gardés, mais leur nombre total était très réduit. Ils n’étaient pas vraiment nécessaires, puisque presque chaque signification adjectivale pouvait être obtenue en ajoutant -able à un nom-verbe. Aucun des adverbes actuels ne fut gardé, exceptés quelques-uns qui se terminaient déjà en -ment : cette terminaison en -ment était invariable. Le mot « bon », par exemple, fut remplacé par « bonnement ».